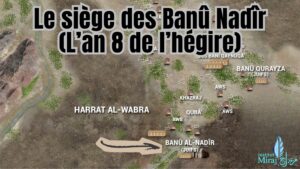
PARTIE 37 : LE SIÈGE DES BANÎ NADÎR (L’AN 4)
Nous avons vu dans le chapitre précédent que ‘Amr b. Umayya avait tué deux innocents des tribus du Najd en
Nouveau livre Sourate Yusuf en vente

Le soutien des Banû Hâshim et des Banû al-Muttalib
Tenter de tuer le Messager de Dieu ﷺ est une idée qui hante l’esprit des Qurayshites depuis le début de la prédication publique. En l’an 7 de la révélation, voyant les réunions des notables de La Mecque se multiplier, Abû Tâlib devine qu’un complot se prépare. Il annonce fermement que si un mal est fait à son neveu, les Banû Hâshim le défendront jusqu’à la mort. Les Qurayshites sont atteints moralement, mais ils ne renoncent pas à leur projet. Ce climat de tension pousse Abû Tâlib à rassembler les Banû Hâshim et les Banû al-Muttalib pour organiser la protection du Prophète ﷺ. Tous décident de se tenir à ses côtés, qu’ils soient musulmans ou non. Les divergences religieuses ne créent aucune friction dans le clan : l’unité tribale prime. D’ailleurs, plus tard, les musulmans ne combattront pas les idolâtres pour leur incroyance, mais pour leur injustice manifeste. Après concertation, les notables de La Mecque choisissent de décréter un blocus total. Ils interdisent tout commerce et toute relation sociale avec les Banû Hâshim et les Banû al-Muttalib. Pour leur échapper, ces derniers se retirent dans un vallon situé nous loin de leur quartier. Le boycott dure trois ans. Sur le plan économique, aucun marchand n’est autorisé à leur vendre quoi que ce soit. Certains arrivent néanmoins à leur faire passer quelques vivres en cachette. Socialement, toute alliance ou mariage avec eux est interdit. Il est même défendu de leur adresser la parole. Pour garantir l’application de ces mesures, les notables de Quraysh rédigent un pacte écrit et le suspendent à l’intérieur de la Ka‘ba. Ce texte est rédigé par Baghîd b. ‘Âmir, dont la main se paralyse peu après.
Les Banû Hâshim résistent. La faim les accable au point qu’ils mangent des feuilles d’arbres. Une nuit, l’un d’eux se réjouit d’avoir trouvé un vieux morceau de peau d’animal qu’il fait bouillir avant de le manger. Ils implorent les commerçants pour nourrir leurs enfants affamés, mais Abû Lahab les devance et leur donne de l’argent pour qu’ils refusent de vendre. Les prix des produits sont parfois multipliés, et chaque nuit, les pleurs des femmes et des enfants affamés résonnent dans le vallon. Le Prophète ﷺ souffre aussi de la faim ; il ne se nourrit que grâce à Bilâl qui parvient à lui faire passer un peu de nourriture, cachée sous son aisselle. Son épouse Khadîja, bien qu’âgée de plus de soixante ans, participe à l’effort de résistance en mettant ses ressources au service de la communauté. Abû Tâlib, malgré son âge, reste ferme dans sa décision. Les musulmans des autres clans continuent, eux aussi, de subir l’oppression. Pourtant, ils ne fléchissent pas. Le Prophète ﷺ poursuit sa mission, notamment pendant la saison du pèlerinage, profitant du respect des mois sacrés pour appeler les tribus arabes à l’islam. Les notables de La Mecque n’osent pas agir contre lui à ce moment-là. Ce sont également durant ces mois que les bannis quittent le vallon pour chercher de quoi se nourrir à l’extérieur de la ville. Les Quraychites pensaient que ce siège viendrait à bout des musulmans. Mais pendant trois années, ils tiennent bon.
Fin de l’embargo
Le blocus dure depuis trois ans, et les Qurayshites commencent à se lasser face à la détermination des musulmans. Les mesures mises en place n’ont pas produit les effets escomptés. Bien au contraire, les croyants en sortent raffermis dans leur foi. C’est alors que cinq notables mecquois — Hishâm b. ‘Amr, Zubayr b. Abû Umayya, al-Mut‘im b. ‘Adî, Abû al-Bukhtarî b. Hishâm et Zam‘a b. al-Aswad — décident d’agir. Ils s’accordent pour réclamer la levée du boycott et la destruction du document qui l’officialise. Ensemble, ils conviennent de se rassembler auprès de la Ka‘ba en présence d’Abû Jahl, afin de simuler une demande unanime et de rallier les autres habitants à leur initiative. Très vite, la discussion devient une dispute. Les cinq contestataires défendent leur position avec fermeté : il n’est plus admissible de maintenir un tel blocus contre leurs propres concitoyens. Au même moment, Abû Tâlib, assis dans un coin du sanctuaire, s’avance et s’adresse à l’assemblée. Il affirme que son neveu a reçu une révélation : Dieu a ordonné à des termites de dévorer le document du pacte, n’épargnant que les mots : « En Ton nom, ô Dieu ». C’est l’ange Gabriel qui en a informé le Prophète ﷺ. Abû Tâlib propose alors un marché aux Qurayshites : si la parole de Muhammad ﷺ s’avère fausse, il accepte de le livrer sans opposer la moindre résistance ; si elle est vraie, le boycott devra cesser immédiatement. Abû Jahl et les notables de Quraysh acceptent. Ils se rendent dans la Ka‘ba pour examiner le document. À leur grande surprise, ils constatent que les termites ont bien détruit tout le texte, sauf l’invocation initiale. Devant cette preuve, les Mecquois mettent fin au blocus économique et social visant les Banû Hâshim et leurs alliés, les Banû al-Muttalib. Durant toute cette épreuve, les deux clans — qu’ils soient musulmans ou polythéistes — sont restés solidaires dans la défense du Prophète ﷺ. En dépit des différences religieuses, aucune tension n’a divisé les membres du clan. Plus tard, lorsque les musulmans seront amenés à combattre, ce ne sera jamais pour l’incroyance des Qurayshites, mais en réponse à leur oppression et à leur injustice. Concernant les musulmans, une question se pose : où étaient-ils durant cette épreuve ? La majorité avait émigré en Abyssinie. Ceux qui étaient restés à La Mecque, soit cachaient leur foi, soit avaient rejoint le Prophète ﷺ par solidarité. Mais ils n’étaient qu’une poignée.
Cette période d’oppression et d’isolement dura trois longues années. La société mecquoise, étroite et hostile, ne laissait guère de répit aux croyants. Le seul lien qui les unissait et les maintenait debout était celui de la foi, cette lumière intérieure qui leur permettait de tenir face aux vents contraires. Les promesses divines de victoire, de soulagement et de paix leur avaient été répétées. Pourtant, ils ne voyaient que la violence, la peur, les sarcasmes et l’injustice. Étrangers sur leur propre terre, les musulmans vivaient dans l’attente douloureuse d’un dénouement. Cette attente alimentait une indignation profonde contre ceux qui, non contents de rejeter la Vérité, piétinaient les valeurs humaines les plus nobles et tournaient en dérision le Jour du Jugement. Mais ce n’était pas tant pour leur propre délivrance qu’ils espéraient la victoire, que pour voir les tyrans humiliés et les injustes corrigés. Or, la révélation leur rappelait sans cesse que la délivrance ne devait pas être précipitée. Il fallait rester fermes, reconnaissants, et s’ancrer dans la certitude du sens profond de leur engagement. Ils devaient puiser dans la foi la force de supporter l’adversité, et louer Dieu pour les vérités éternelles auxquelles ils avaient eu accès. Le Coran leur disait : « Que Nous te fassions assister à une partie du châtiment que Nous leur réservons ou que Nous te rappelions auparavant auprès de Nous, c’est vers Nous de toute façon que se fera leur retour. Dieu est, en outre, Témoin de tous leurs actes. Et à chaque communauté il a été désigné un prophète en présence duquel elle sera jugée en toute justice, sans qu’elle subisse la moindre iniquité » [10 : 46 et 47].
Les négateurs, quant à eux, ricanant de ces promesses qu’ils jugeaient illusoires, attendaient eux aussi un dénouement — convaincus que rien ne pourrait faire vaciller leur pouvoir ou remettre en cause l’ordre établi. Ils ne pouvaient imaginer que la Mecque, remplie de statues, résonnerait un jour de l’appel au monothéisme ; que les opprimés du vallon deviendraient les maîtres de la cité ; et que les bourreaux d’hier en viendraient à supplier la clémence. Leurs moqueries traduisaient leur aveuglement : « Quand donc viendra cette promesse, si vous dites vrai ? » disaient-ils. Et la révélation répondait : « Les incrédules disent : ‘À quand cette promesse, si vous êtes véridiques ?’ Réponds-leur : ‘Je ne détiens aucun pouvoir sur ce qui peut m’arriver en bien ou en mal, en dehors de ce que Dieu veut.’ À chaque communauté est fixé un terme que, quand il échoit, elle ne peut, ne serait-ce que d’un instant, ni avancer ni reculer. Dis : ‘Que vous en semble ? Si le châtiment de Dieu devait venir vous surprendre de nuit ou de jour, à quoi servirait aux coupables d’avoir hâte de le voir se produire ? Est-ce au moment où ce châtiment s’abattra sur vous que vous croirez enfin ? Alors que, la veille encore, vous en réclamiez [avec ironie] la prompte arrivée !’ » [10 : 48 à 51].
L’adhésion à l’Islam, à ses débuts, ne pouvait être motivée par un quelconque intérêt personnel. Il est possible d’adopter certaines idées tout en y cherchant un bénéfice, une reconnaissance ou une promotion. Mais pour les premiers musulmans, cette option était exclue : embrasser l’Islam, c’était accepter de perdre ses biens, sa position, voire sa sécurité. Leur engagement était pur, nourri par la quête de vérité pour elle-même. Leur foi n’était pas un levier pour obtenir un gain, mais un dépassement de soi inspiré par la sincérité et le sens profond de la mission divine. Dieu dit : « Ceux dont l’ambition se limite aux plaisirs et au faste de ce monde, Nous rétribuerons leur efforts dans ce monde même, sans leur faire subir la moindre injustice ; mais ceux-là n’auront dans la vie future que le Feu, car toutes leurs oeuvres ici-bas seront vaines et tout ce qu’ils auront accompli sur Terre sera sans valeur » [11 : 15 et 16]. C’est dans cet esprit que les compagnons du Prophète ﷺ ont puisé une noblesse d’âme, une fidélité et une chasteté morale jamais égalées dans l’histoire des hommes. Lorsque les sceptres des souverains tombèrent et que les trésors des nations leur furent offerts, leur regard ne se tourna ni vers l’or ni vers l’argent. Leur seul objectif restait intact : faire triompher la vérité, établir la prière, purifier les biens par l’aumône, encourager le bien et interdire le mal. Même durant les trois années d’enfermement dans le vallon, sous le poids de la faim, de l’isolement et de l’injustice, ils ne cessèrent pas de transmettre l’Islam à ceux qui venaient à la Mecque pour le pèlerinage. Car les épreuves ne tuent pas la prédication ; elles en affermissent les racines et renforcent sa propagation. Chaque souffrance subie en chemin devenait un ferment de foi, chaque difficulté rencontrée une lumière vers l’au-delà.
**********
Certains ont voulu réduire la mission du Prophète ﷺ et la foi de ses compagnons à une simple révolte de démunis. Pourtant, lorsque l’on prend la mesure de ce que le Prophète ﷺ et ses premiers disciples ont enduré, il devient difficile de croire à une insurrection motivée par la faim ou la jalousie sociale. Si leurs revendications étaient uniquement matérielles, pourquoi refuser les propositions des Qurayshites qui leur offraient le pouvoir, la richesse et la paix, à condition d’abandonner leur appel à l’islam ? Pourquoi les compagnons n’ont-ils jamais reproché à leur guide de rejeter de telles offres, s’ils n’aspiraient qu’à une amélioration de leur condition ? Le Prophète ﷺ et ses compagnons ont accepté de vivre en marge de la société mecquoise. Exclus, affamés, assiégés, ils durent parfois se contenter de feuilles pour se nourrir. Ils ont tenu bon, soutenus par l’exemple du Prophète ﷺ, patient et digne. Est-ce là l’attitude de révolutionnaires animés par l’ambition ? Leur émigration à Médine les obligea à abandonner leurs biens, leurs maisons et leurs terres. Aucun attachement matériel ne pouvait rivaliser avec leur lien à Dieu. L’amour de l’Au-delà l’emportait largement sur toute ambition terrestre.
Certains expliquent mal cette démarche en avançant deux arguments trompeurs : d’abord, que les premiers convertis étaient souvent des esclaves, des opprimés et des marginaux, ce qui ferait de leur foi un simple espoir d’échapper à leur sort ; ensuite, que les musulmans connurent plus tard des victoires éclatantes, ce qui laisserait croire que ces succès avaient été prémédités. Mais ces interprétations ignorent l’essentiel. Il est naturel que les opprimés soient plus enclins à embrasser une religion de justice et de vérité. Les puissants, eux, la redoutaient, car elle menaçait leur emprise. Ce n’est pas une coïncidence si les riches notables de Quraysh se sont opposés farouchement au message. Ceux qui croyaient au Prophète ﷺ le faisaient par conviction profonde, et non pour des intérêts cachés. Les prétentions selon lesquelles il aurait convoité le pouvoir, ou que ses disciples l’auraient suivi par ambition, ne résistent pas à l’analyse. Que les musulmans aient conquis de vastes territoires ne signifie pas qu’ils poursuivaient ces conquêtes dès le départ. Si leurs motivations avaient été uniquement politiques ou économiques, Dieu ne leur aurait pas accordé la victoire. Le succès fut une conséquence de leur foi et non son objectif. Le Coran le rappelle clairement : « Or, Nous voulions apporter Notre aide à ces opprimés sur Terre, pour faire d’eux des dirigeants et des héritiers » [28 : 5]. Cette loi divine est évidente pour quiconque réfléchit avec sincérité et se libère de ses préjugés.
Animés par une foi sincère et une quête du salut dans l’au-delà, le Prophète ﷺ et les premiers musulmans endurèrent les privations et les épreuves avec patience et courage. Leur but ultime était de satisfaire Dieu en Lui obéissant ici-bas pour mériter Sa bénédiction. Il est important de rappeler ce point, car certains esprits dominés par des grilles de lecture impérialistes insinuent que la mission du Prophète ﷺ serait en réalité motivée par l’esprit de clan des Banû Hâshim et des Banû al-Muttalib. Selon cette vision biaisée, ces deux clans auraient défendu avec ferveur la cause de Muhammad ﷺ par simple solidarité tribale, notamment face au blocus imposé par les Qurayshites. Une telle hypothèse est non seulement infondée, mais aussi illogique. Il est certes compréhensible, dans une société encore imprégnée des réflexes de l’ère préislamique, que des liens tribaux incitent à protéger un parent menacé par des clans adverses. Mais ce sentiment de loyauté n’était pas lié à la reconnaissance de la véracité du message prophétique. Il s’agissait d’un attachement tribal aveugle, sans considération du juste ou de l’injuste. C’est d’ailleurs pourquoi certains proches du Prophète ﷺ le soutenaient tout en demeurant mécréants, se contentant de le défendre contre leurs propres pairs polythéistes. Cette protection tribale n’a en réalité jamais été un soutien direct à la mission spirituelle du Prophète ﷺ. Elle fut même inefficace sur le plan pratique : les Qurayshites poursuivirent leur persécution, infligeant aux Banû Hâshim et aux Banû al-Muttalib les mêmes épreuves qu’aux compagnons musulmans. Ils leur démontrèrent ainsi l’inanité de leur opposition. Quant au Prophète ﷺ, il ne tira aucun avantage direct de cette protection. Elle ne représentait qu’un rempart familial contre une violence tribale croissante. Cela dit, il n’y a aucun mal à ce que les musulmans, par la suite, s’inspirent de cette stratégie pour faire face aux polythéistes et déjouer leurs complots. Toute forme de soutien peut servir à protéger l’essentiel : la mission prophétique et la transmission du message divin.
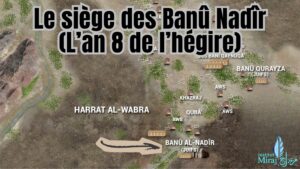
Nous avons vu dans le chapitre précédent que ‘Amr b. Umayya avait tué deux innocents des tribus du Najd en
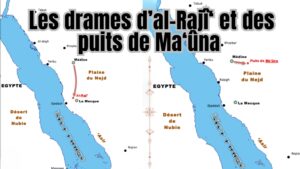
Après la bataille d’Uhud, deux mois de calme s’installent. Mais cette accalmie n’est que passagère, car plusieurs tribus arabes alliées

En l’an trois de l’Hégire, les Mecquois envoient une riche caravane chargée d’argenterie en direction de l’Irak, sous la conduite

Bien qu’un pacte ait été conclu entre les musulmans et les juifs de Médine, ces derniers ne se considèrent pas